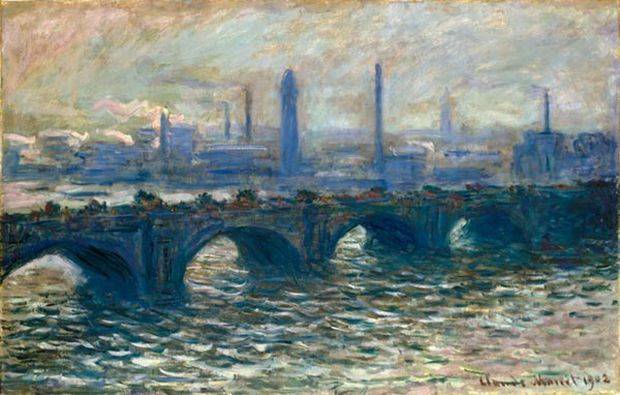Frances Burney a eu neuf frères et sœurs, parmi eux Sarah Harriet Burney qui était aussi auteure. Elle est née en 1772, soit vingt ans après Frances Burney, du second mariage de Charles Burney. Élevée jusqu’à ses trois ans par des amis de sa mère puis envoyée dans une école suisse en 1781 avec son frère Richard, Sarah Harriet Burney n’a pas vraiment grandi dans le cocon familial. Elle revient en 1783, sachant parfaitement parler l’italien et le français.
Le début de sa vie d’adulte est marqué par la maladie de ses parents, dont elle s’occupe jusqu’à leur mort. Elizabeth Allen meurt en 1796 et Charles Burney en 1814. Le caractère de son père étant difficile à supporter au quotidien, elle part du domicile familial de 1798 à 1803 pour vivre avec son frère James, tout juste séparé de sa femme. Cette période de vie commune est très mal considérée, ils sont même accusés d’inceste par certains. Une période d’autant plus dure qu’elle n’avait que très peu d’argent. Finalement, James retournera auprès de sa femme et Sarah Harriet acceptera un poste de gouvernante. Ces événements n’ont bien évidemment pas améliorés la relation conflictuelle qu’elle avait avec son père. A la mort de ce dernier, après avoir tout de même pris soin de lui durant de nombreuses années, Sarah Harriet Burney n’a droit qu’à une maigre part d’héritage.
En 1829, Sarah Harriet Burney s’installe en Italie (entre autres parce que la vie y est moins chère), elle y restera quatre ans. Elle y rencontre notamment l’auteur Walter Savage Landor (Imaginary Conversations; 1775-1864) et l’avocat Henry Crabb Robinson (1775–1867). En 1833, elle décide de revenir à Bath. Elle y reste jusqu’en 1841 puis déménage à Cheltenham où elle meurt en 1844 (quatre ans après la mort de Frances Burney) dans une situation financière délicate.
Carrière littéraire
De 1796 à 1839, Sarah Harriet Burney, par ailleurs grande admiratrice de Sir Walter Scott et de Jane Austen, publie six romans: Clarentine (1796), Geraldine Fauconberg (1808), Traits of Nature (1812), Tales of Fancy: The Shipwreck (1816), Tales of Fancy: Country Neighbours (1820) et The Romance of Private Life: The Renunciation and The Hermitage (1839).
Ses deux premiers romans, publiés anonymement, n’ont pas le succès escompté. En revanche, son troisième roman, Traits of Nature, est bien accueilli par le public puisqu’il est réédité jusqu’en 1820. Son éditeur Henry Colburn la rémunére alors 250£. Il est même traduit en français en 1812 sous le titre Tableaux de la nature. Tout comme le premier tome des Tales of Fancy, traduit en français mais aussi en allemand et publié au Etats-Unis. Ce quatrième ouvrage lui rapporte 100£. Son dernier roman, The Romance of Private Life est lui aussi édité pour le public américain en 1840.
Malgré quelques succès, la carrière littéraire de Sarah Harriet Burney ne lui permet pas d’avoir des revenus suffisant pour vivre aisément. Cependant, ce revenu, complété par un salaire de gouvernante, ou de dame de compagnie selon la période, lui garanti son indépendance.
De nos jours, même si les œuvres de Sarah Harriet Burney sont disponibles en impression à la demande, elles restent relativement inconnues que ce soit en Angleterre, dans le reste de l’Europe ou aux Etats-Unis. Toutefois en 1997, l’intégralité de ses lettres a été regroupée en un ouvrage par Lorna J. Clark., The Letters of Sarah Harriet Burney (University of Georgia Press).
Ainsi, Sarah Harriet Burney est dans l’ombre littéraire de sa sœur Frances Burney dont le roman Evelina fait partie des classiques de la littérature anglaise de cette époque.
Ses relations avec sa sœur Frances
En octobre 1775, Sarah Harriet revient au domicile familial après avoir passée ses premières années chez des amis de sa mère, Frances confie alors son enthousiasme dans une lettre: « Little Sally is come home & is one of the most innocent, artless queer little things you ever saw, she is a very sweet, & very engaging child. » Si les deux sœurs entretiennent de bons rapports tout au long de leurs vies, il est vrai que leur grande différence d’âge ne leur a pas permis de développer une relation de complicité. En effet, lorsque Sarah Harriet n’a que six ans, Frances publie Evelina.
Au début des années 1790, une cause commune les rapproche : l’accueil des émigrés français fuyant la Révolution. En 1792, elles se retrouvent toutes les deux à Bradfield, dans une maison appartenant à leur oncle et dans laquelle les réfugiés politiques français sont les bienvenus. Lorsque Frances épouse le Général Alexandre d’Arblay (rencontré à Juniper Hall), Sarah Harriet est ravie et tente de dresser un portrait positif de ce dernier à son père, réfractaire à l’idée que sa fille se marie avec un émigré français. A contrario, lorsque Sarah Harriet part du domicile familial pour vivre avec son frère, c’est Frances qui essaye d’apaiser les rapports entre sa sœur et son père.
A sa mort, Frances, qui savait que Sarah Harriet était dans le besoin, lui lègue la somme de 1000£.
Une femme indépendante mais seule
Sarah Harriet Burney apprend la solitude dès sa plus tendre enfance. En effet, ses frères et sœurs étant bien plus âgés qu’elle (elle est devenue tante pour la première fois l’année de sa naissance), elle se retrouve la seule enfant parmi de nombreux adultes. De plus, élevée par des amis de sa mère puis envoyée dans une école en Suisse, Sarah Harriet est quelque peu mise à l’écart du clan Burney. Elle se sent différente, elle n’est pas vraiment un membre de cette famille. Ce sentiment est ressentie par plusieurs de ses héroïnes comme Adela dans Traits of Nature, abandonnée par ses parents et adoptée par une famille au sein de laquelle elle a l’impression d’être une étrangère.
Sarah Harriet doit aussi supporter la constante comparaison faîte par son père entre ses romans et ceux de sa sœur Frances, ce dernier trouvant que Sarah Harriet a un talent moindre. Par exemple, il confie dans une lettre adressée à Frances que le début de Clarentine, premier roman de Sarah Harriet, est « embarassed & incorrect ». Ainsi, elle développe un certain manque de confiance en soi qui la suivra durant toute sa carrière littéraire.
Adulte, Sarah Harriet Burney est une femme intelligente qui aime apprendre et débattre et qui n’accorde que peu d’importances aux conventions sociales. Préférant la compagnie des hommes à celles des femmes, elle n’a que peu d’amies au cours de son existence. La période la plus heureuse de sa vie, comme le suppose Lorna J. Clark, est son séjour à Rome, entourée d’Henry Crabb Robinson et de ses camarades. Ce dernier la décrit dans ses lettres comme étant joyeuse et maîtrisant l’art de la conversation. Malheureusement, ce n’est pas l’avis de sa nièce qui séjourne en Italie au même moment et qui considère que Sarah Harriet n’est pas une bonne fréquentation pour sa fille Charlotte. Elle est donc encore une fois de plus rejetée et jugée par des membres de sa famille, comme lorsqu’elle a vécu avec son frère James quelques années auparavant.
Les lettres de Sarah Harriet Burney prouvent qu’elle a eu de nombreuses relations amicales mais ces dernières n’ont jamais duré. L’une des principales raisons à cela est son manque de revenus. En effet, sa situation financière l’a empêchée d’avoir une vie sociale remplie, ses connaissances faisant partie de la haute société anglaise. Les nombreuses années passées au chevet de ses parents ont probablement aussi participé à son isolation. Ses lettres montrent à quel point elle vivait mal cette solitude non désirée.
Sarah Harriet Burney était la fille de Charles Burney et la sœur de Frances Burney mais elle était aussi bien plus que cela. Elle était une écrivaine indépendante, intelligente et ouverte d’esprit.
Sitographie
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Burney
http://www.mcgill.ca/burneycentre/resources/sarah-harriet-burney-1772-1844
Bibliographie
CLARK Lorna J., The Letters of Sarah Harriet Burney, University of Georgia Press, Georgia, 1997.
SABOR Peter (dir.), The Cambridge Companion to Frances Burney, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.


 Voici l’une de ses dernières lettres, adressée à sa sœur Charlotte Broome et sa nièce Charlotte Barrett le 20 avril 1838 :
Voici l’une de ses dernières lettres, adressée à sa sœur Charlotte Broome et sa nièce Charlotte Barrett le 20 avril 1838 :